GENEALOGIE L'ELEU
HISTOIRE
DE
LA FAMILLE L’ELEU
Origines de la famille
Origine onomastique
Jusqu'au XIIème siècle,
nos ancêtres étaient appelés par leur prénom
ou leur diminutif, suivi de fils ou fille de ... comme c'est encore le cas
dans certains pays du Moyen-Orient. A partir des XII et XIIIème siècle,
la forte augmentation de la démographie obligea à résoudre
des problèmes d'homonymie : on rajouta alors un surnom ou un diminutif
ou une provenance ou encore un métier, qui se fixa au cours des siècles
et devint le nom de famille héréditaire vers le XIVème.
Les anglo-saxons se le rappellent puisqu'ils désignent le nom de
famille par le mot surname.
Il faut encore remarquer qu'autrefois, on ne s'attachait pas à l'orthographe
des noms qui n'a été figée qu'à la fin du XIXème
siècle avec l'institution du Livret de famille : cela explique que,
parfois dans un même texte, on trouve plusieurs orthographes pour
désigner un même personnage.
Comme nous le verrons plus loin, le nom complet L’Eleu de La Simone n’apparait qu’en début de XIXè. Pour retrouver nos ancêtres avant la Révolution, il faut faire des recherches sur le nom de L’Eleu. Ces recherches s’appuient sur la généalogie familiale réalisée par Xavier de Buttet.
Le nom de notre premier ancêtre connu a été relevé dans les archives de la paroisse Saint-Rémy-au-Parvis de Laon, dans l'acte de naissance, le 12 janvier 1628, de Marie, fille de «Claude Leleup et Magdelaine Laurent sa femme… le parrain fut Artus Le leup… ». En voici la copie :
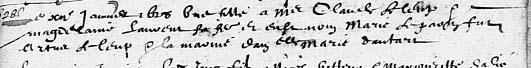
Cette orthographe a été
utilisée à la naissance des cinq premiers enfants de Claude.
Celui-ci change ensuite de paroisse et le nouveau scribe utilise Leleu.
Le nom s’écrit ensuite, suivant la fantaisie du scribe, Leleu
ou Le Leu (ainsi dans l'Armorial d'Hozier de 1691). L’auteur d’une
fameuse histoire de Laon est notre grand-oncle resté sous le nom
de chanoine Le Leu décédé en 1726.
L’écriture L'Eleu apparaît une fois à la naissance
d’André en 1691, puis définitivement à partir
de 1738, à la naissance d'André Joseph, fils de Simon.
La première écriture connue est donc le leup. Le leup ou le
leu veut dire le loup en langue picarde. Le nom doit venir du surnom donné
à l'un de nos ancêtres. Son écriture a évolué
jusqu'au XVIIIème lorsque Simon, avocat, gouverneur échevin
(c'est-à-dire élu par les bourgeois de Laon) a adopté
l'écriture « l'Eleu » plus conforme à son statut
social. Cette écriture a été définitivement
adoptée jusqu'à nos jours.
Origine géographique
Dans des formes orthographiquement approchées,
on trouve à maintes reprises le nom dans l'histoire de la Picardie.
Xavier de Buttet écrit dans la première page de sa généalogie:
Une ancienne tradition fait descendre la famille l'Eleu des Seigneurs
de Sons en Thiérache , Canton de Marle, à environ 20 kilomètres
au nord de Laon. Nous trouvons en effet Guillaume l'Eleu seigneur de Sons
qui vivait vers 1350 et mourut en 1384. Son fils Jean l'Eleu, seigneur de
Sons, mentionné par Caumartin, nobiliaire de Champagne , mourut en
1425 après avoir fondé, par son testament, une messe en l'église
de St-Quentin. Il est mentionné dans les manuscrits de Claude l'Eleu,
Seigneur de la Bretonne, Vicaire-Général de Mgr l’Evêque,
dont les écrits ont une grande valeur historique. Y figure également
son fils Jean II seigneur de Sons en 1425.
On trouve encore dans les écrits de Claude l'Eleu la mention de Jean
l'Eleu, de St-Quentin, homme fort entendu dans la profession des armes "
qui prit part en 1354 au siège du château de Roucy, en qualité
de commandant des troupes envoyées par les villes de Laon et Reims
sous la direction de Gaucher de Châtillon, de Georges l'Eleu, chanoine
de Cambrai en 1500. Est cité encore Pierre l'Eleu, prévôt
de la cathédrale de Cambrai en 1512
Une ancienne tradition regarde aussi comme de la famille l'Eleu trois frères
de ce nom, commandant des Corps de troupes au service de la Ligue, mentionnés
dans un manuscrit de Moreau, qui a toujours été conservé
par l'aîné de la famille depuis la mort de M.l'Eleu de Servenay
qui en a été possesseur, d'après Dom Lelong, Bibliothèque
de l'histoire de France.
L'apostrophe n'étant apparue que vers 1550, il est probable que l'écriture
du nom dans le texte original a été transformée en
l'Eleu par Xavier de Buttet par soucis d'homogénéité.
On peut le supposer à la lecture d’un article trouvé
dans l'annuaire du conseil héraldique de France, volume Al 1 de 1888
au sujet d'une Marie Catherine Lesleu de Poix qui s'était comportée
en héroïne au siège de Péronne de 1536:
A propos de Lesleu, c'est très certainement une forme erronée
de Le Leu. La forme initiale du mot élu était esleu, puis
on a écrit eleu. L'apostrophe n'étant pas encore en usage,
il pouvait signifier aussi bien le Leu que l'Eleu. Le scribe de 1537, admettant
cette dernière signification, aura écrit le nom sous la forme
archaïque Lesleu. Le Leu était, en effet, celui d'une bonne
famille péronnaise, de ces vieilles bourgeoisies qui vivaient noblement
et portaient volontiers les armes, à l'égal des gentilshommes.
Très ancienne en Picardie, elle avait provigné en Artois,
en Beauvoisis et dans Ille-de-France, avec des fortunes diverses. Baudry
le Leu est nommé, vers 1315, dans le cartulaire de l'abbaye de Thenzilles.
En 1339, Baudouin le Leu, écuyer, de la vicomté de Paris,
est au service du Roi comme chef de compagnie. Le 20 octobre 1376, Gérard
de Dainville, évêque de Cambrai, dénombre ce qu'il tient
du Roi dans la châtellerie de Péronne Item, Jehans le Leu,
ung fief qui contient 7 quartiers de terre qui furent le bon Jehans, seans
au terroir de Hammel. » . En 1380, Guieffrin le Leu est receveur des
aides à Senlis, probablement le même que Geffroy le Leu, en
1385 grenetier du grenier royal de Beauvais. Le 26 mai 1383 « C'est
le denombrement de le cousterie de Péronne que obtient a present
Me Macé Freron, secrétaire du Roy et de mors d'Anjou. A Barluex,
ung fief appartenant à Jehan le Leu dAvesnes, seans au terroir dAvesnes,
contenant deux journées de terre. » En 1387, Louis le Leu est
écuyer dans la compagnie de Robert du Trenquis, et Barthélemy
Leleu, arbalétrier du Roi. En 1388, Baudin le Leu est un des écuyers
commandés par J. de Couppes. Le 7 octobre 1390, dénombrant
au Roi son fief de La Fontaine, J. de Moyencourt, écuyer, mentionne
« les hommaiges du dit fief. Le Leu du Hamel en tient ung fief contenant
trois quartiers de terre. En 1409, Baudot le Leu est bourgeois de Pierrepont.
En 1410, Jean le Leu, écuyer fait montre de sa compagnie de 8 écuyers
et 10 archers.
En conclusion, depuis au moins le XIVème siècle,
la famille est connue sous le nom de Le Leu ou Le Leup (orthographe utilisée
par Artus, notre premier ancêtre certain), appellation picarde du
loup. Sa province d’origine est la Picardie où il semble que
deux branches ou deux familles Le Leu se soient différenciées,
l'une à Péronne, l'autre à Laon, la nôtre. Comme
dit au paragraphe précèdent, c'était une famille faisant
partie de ces vieilles bourgeoisies qui vivaient noblement et portaient
volontiers les armes, à l'égal des gentilshommes.
L’écriture L’Eleu faisant apparaître la notion
d’élu n’a été définitivement adoptée
qu’à partir du XVIIIème siècle.
Ajout de noms de fief
Au fil des siècles, les l'Éleu ont
ajouté à leur nom (en général de façon
momentanée) celui de fiefs dont ils ont hérité ou dont
ils se sont rendus acquéreurs, partagés ensuite entre les
descendants ou vendus par ceux-ci.
Chronologiquement, on voit apparaître les noms de fiefs suivants :
- Lasnier : apparu avec Claude l'Éleu
vers 1650, dont on n'a aucune indication mais qui devait être proche
de Laon.
- Presles : aujourd'hui Presles et Thierny, du
district de Bruyères. Bruyères était autrefois chef-lieu
d'un doyenné rural de l'archidiaconé de Laon. En 1790, il
devint chef-lieu d'un canton du district de Laon. Presles possédait
un chef-lieu de prévôté pour l'exercice de la justice
foncière. Presles semble avoir été longtemps un lieu
de villégiature de la branche aînée depuis 1668 (naissance
d'Élisabeth Anne). Au XXème siècle André l’Eleu
y a acheté une propriété qui a été vendue
en 2010 par ses derniers descendants, Marie de Guillebon (sa petite-fille)
et ses enfants.
- La Bretonne : petit fief de la commune de Chaourse,
vassal de la châtellenie de Pierrepont. Ce fief est apparu avec André
l'Éleu mort en 1691 et a disparu avec Simon Charles mort en 1795.
- Servenay : hameau de la commune d'Aray Sainte
Restitue, canton d'Oulchy le Château situé entre Laon et Château-Thierry.
Ce fief n'apparaît que sur deux générations de 1700
à 1787.
- La Mothe : il existe de nombreux fiefs appelés
la Motte, anciennement écrit la Mothe. Ce fief n'est cité
que pour Simon l'Éleu vers 1770 et ne peut être situé.
- La Ville aux bois : il s'agit de la «
Petite-Ville-aux-Bois », près de Montcornet. Ce village s'appelle
maintenant La Ville-aux-Bois-les-Dizy. Le fief a été transmis
à la famille par Marie Charlotte Jongleur. Le nom de l'Éleu
de la Ville aux Bois disparaît en 1850.
- Lislet : se trouve aussi près de Montcornet.
- Le Bocage : ne figure pas dans le dictionnaire consulté.
- La Simone : ce fief n'apparaît pas non
plus dans le dictionnaire consulté. Il a été transmis
à la famille par Marie Charlotte Jongleur, épouse de Simon
l'Eleu en 1737. Elle le tenait elle-même par héritage de sa
mère née Brucelles. Au nord de Vervins dans l’Aisne,
à 42 km au N.E. de Laon, il existe une petite rivière la Simone
qui prend sa source au pied du mont Simon, traverse Fontaine-lès-Vervins
et conflue vers le Chertemps. La longueur de son cours est de 4,5 km. Le
fief la Simone pourrait bien avoir un rapport avec des terres bordant ce
cours d’eau.
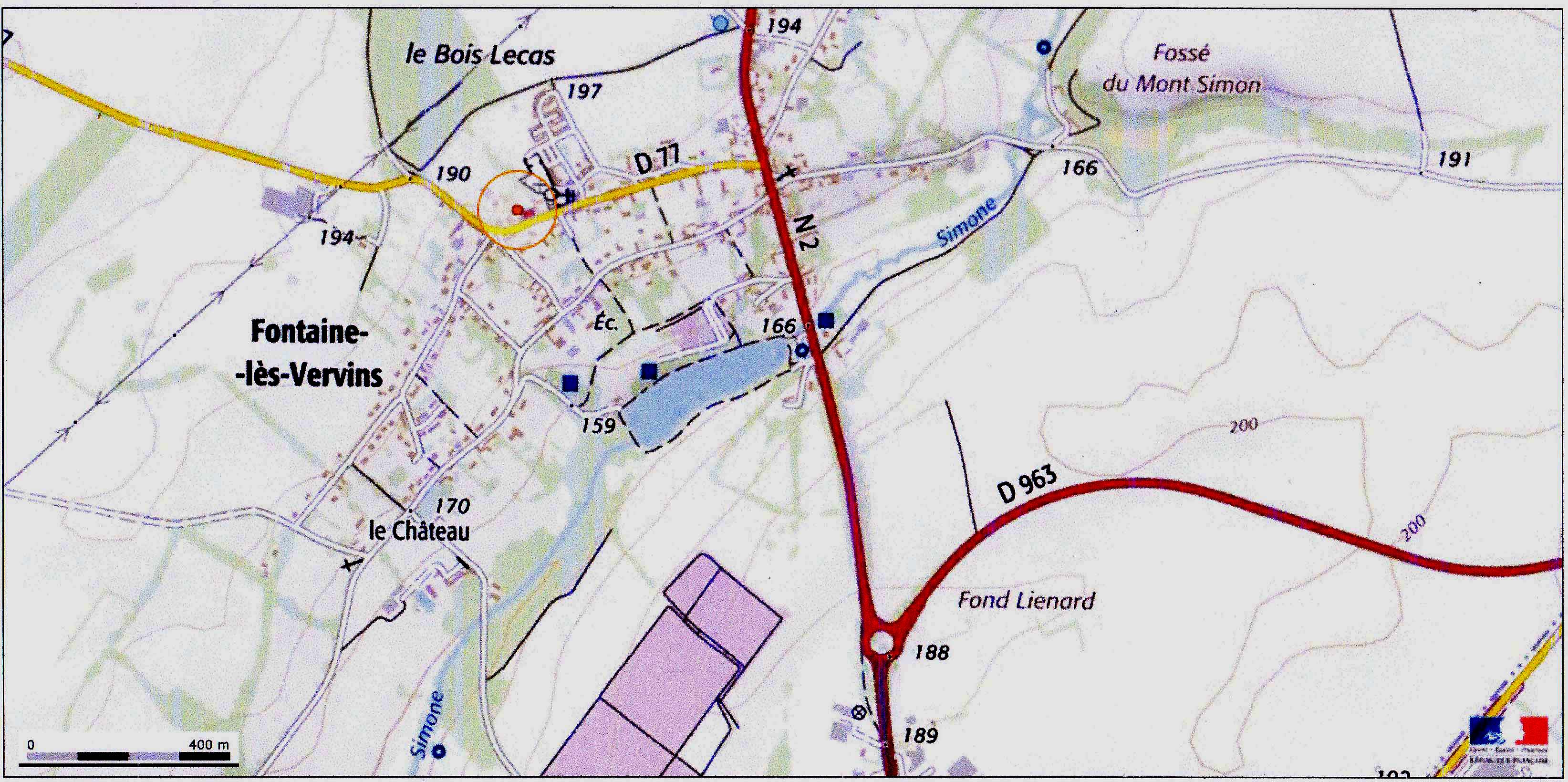
- Le nom de la Simone a été rajouté
à celui de l’Eleu lorsqu’André Simon a été
nommé Chevalier de l’Empire : ce nom est officialisé
dans la lettre patente du 13 août 1811.
NB La Thiérache est une région naturelle qui regroupe des régions de France et de Belgique où l'on retrouve des traits paysagers et architecturaux similaires : présence du bocage, de l'herbage, terrains vallonnés, habitat dispersé, maisons traditionnelles construites en pierres ou en briques avec des insertions en pierre et munies d'une toiture en ardoise. Située au nord-est du département de l'Aisne, elle déborde sur les départements du Nord, des Ardennes, et des provinces belges du Hainaut et de Namur. Elle correspond globalement aux contreforts Ouest du massif ardennais.
